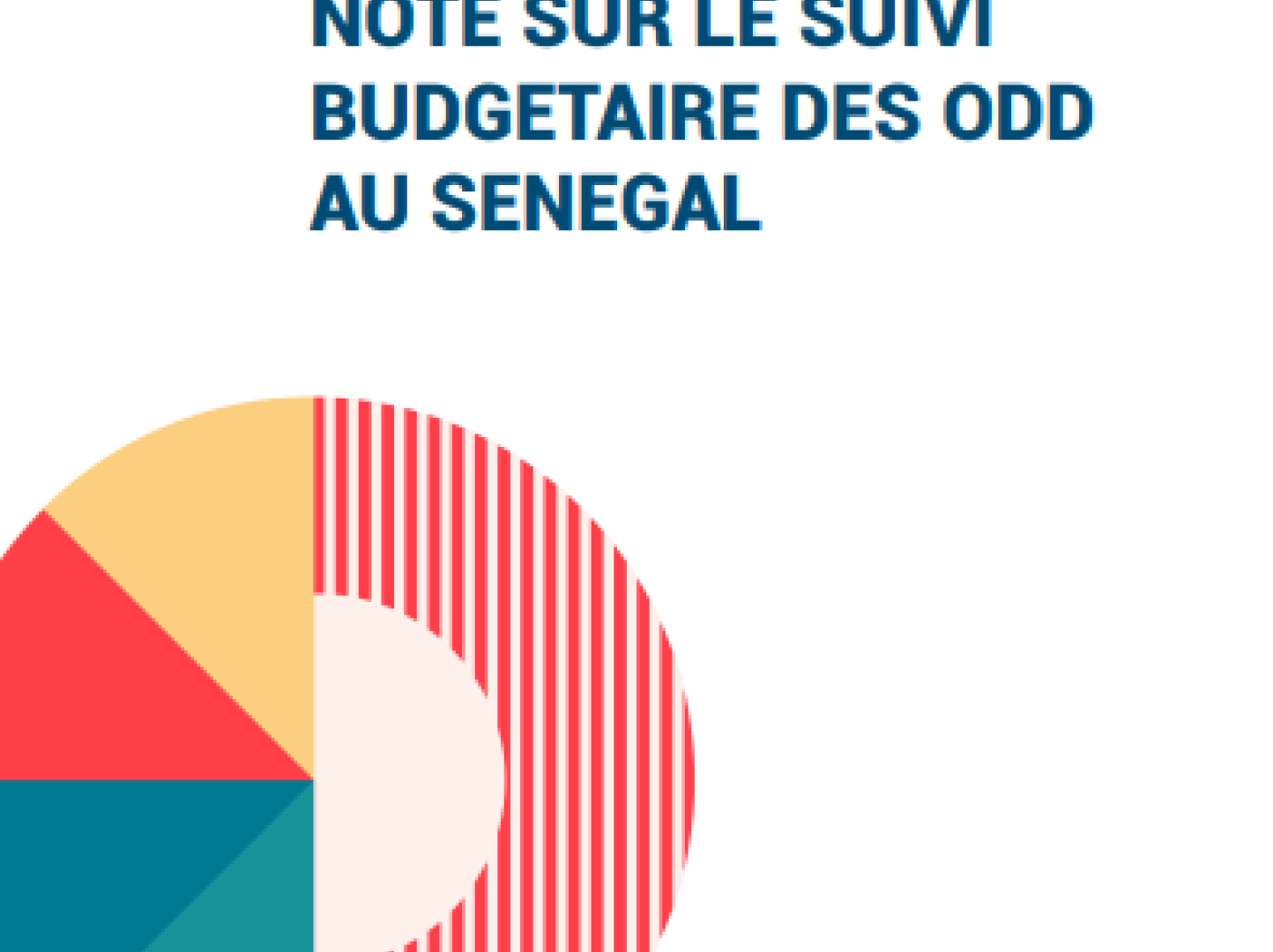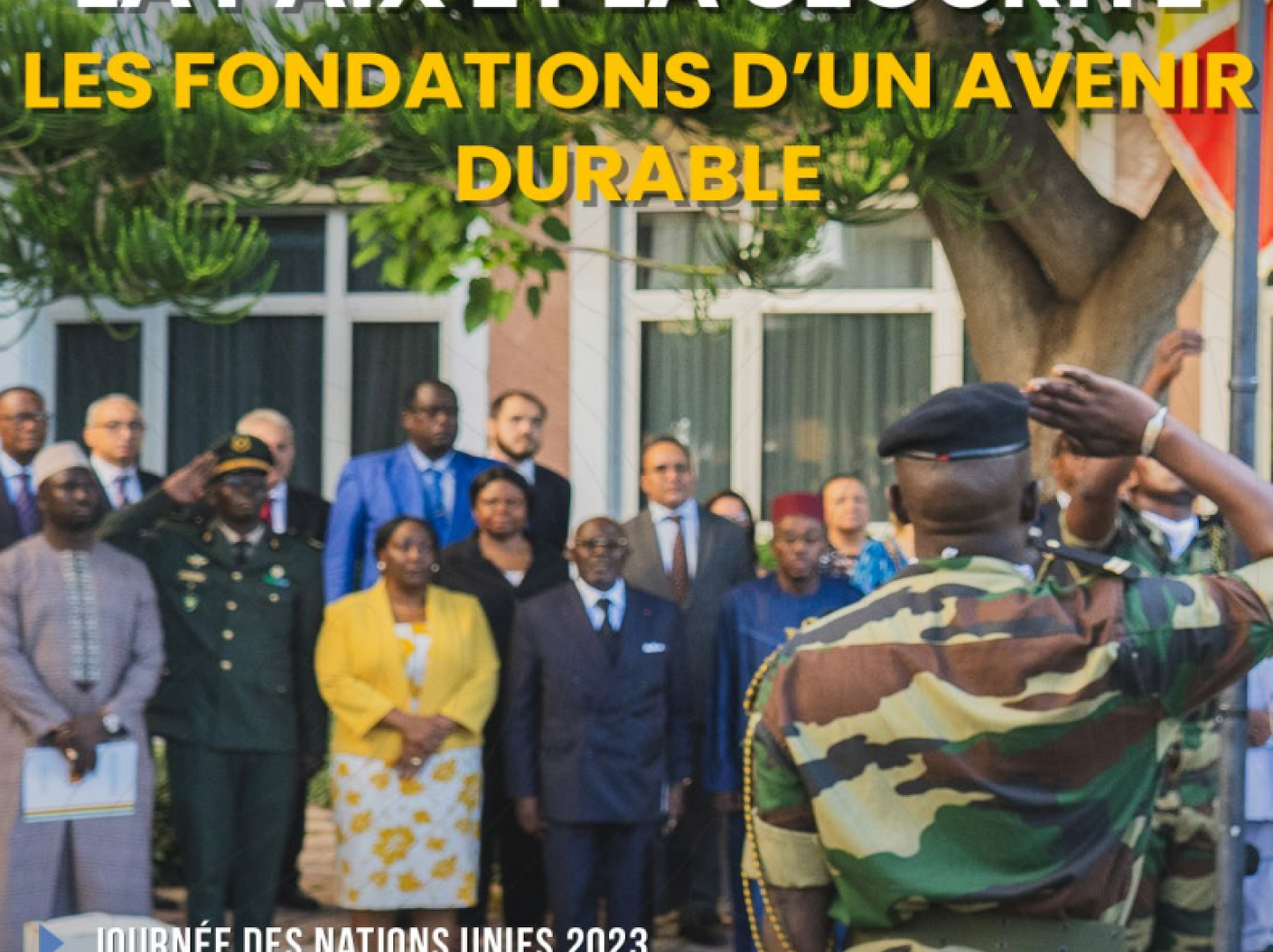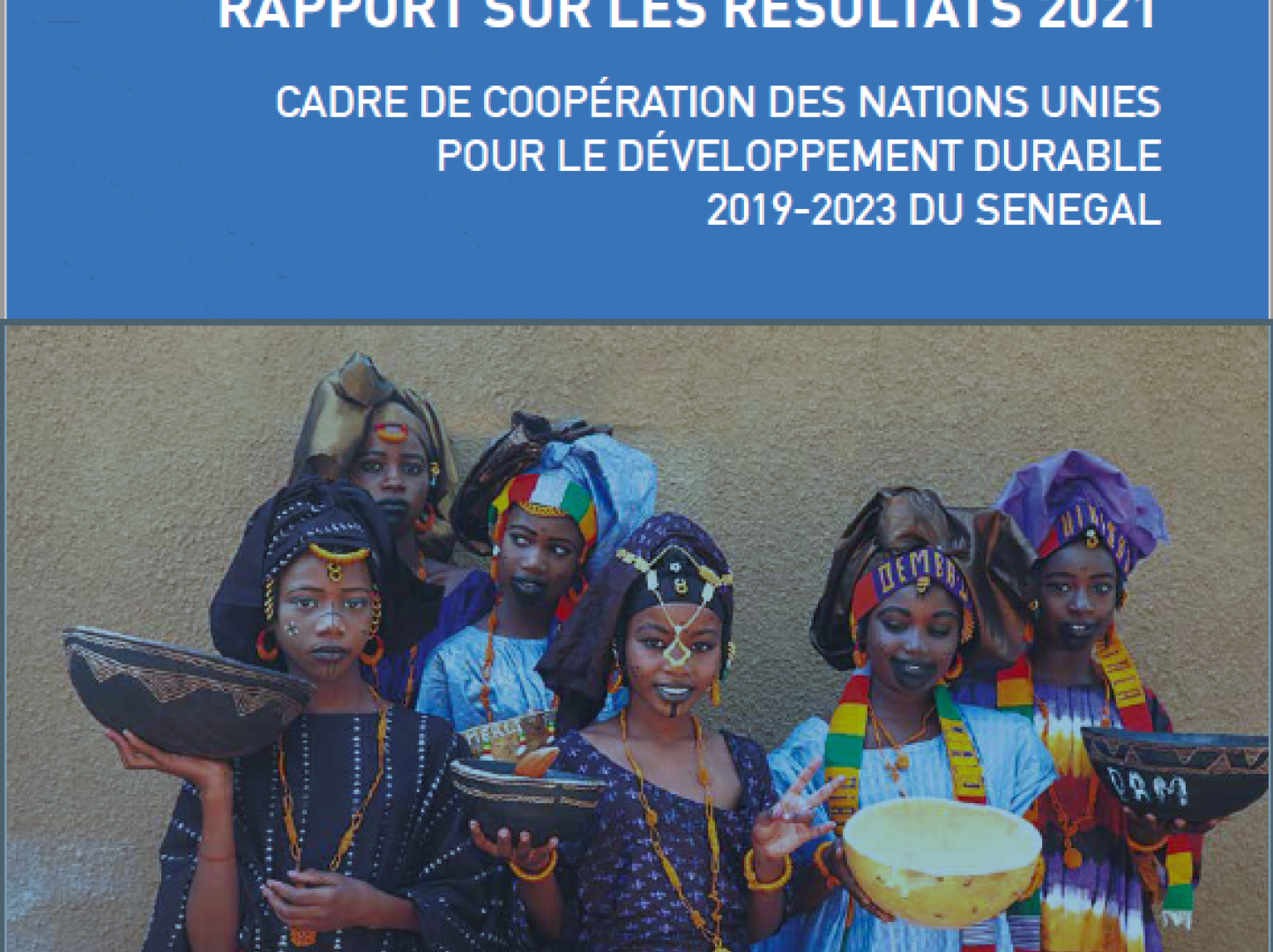Dernières actualités
Histoire
24 décembre 2025
Visite officielle : ONU-Habitat et le Sénégal renforcent leur partenariat pour un développement durable et inclusif
Pour en savoir plus
Histoire
24 décembre 2025
Ziguinchor, pôle de la célébration de la Journée des Droits de l'Homme 2025
Pour en savoir plus
Histoire
24 décembre 2025
Le Sénégal célèbre la Journée internationale des migrants 2025 avec un appel à une migration sûre, ordonnée et régulière
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Sénégal
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Sénégal:
Histoire
24 décembre 2025
Le Sénégal célèbre la Journée internationale des migrants 2025 avec un appel à une migration sûre, ordonnée et régulière
Un appel à une migration sûre, ordonnée et régulière, fondée sur la dignité et le développement durable, a marqué la célébration de la Journée internationale des migrants au Sénégal, le 18 décembre, à l’occasion d’un rassemblement de responsables et de communautés au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, sous le thème : « Mon Histoire Extraordinaire : Cultures et Développement ».L’événement a réuni le Gouvernement, les Nations Unies, la société civile, les migrants et les organisations de la diaspora pour mettre en évidence comment une migration bien gouvernée peut renforcer les communautés, enrichir les cultures et soutenir le développement, tout en protégeant des vies. Président la cérémonie, le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a souligné la nécessité de placer les migrants au cœur de l’action publique et de renforcer la collaboration entre institutions, communautés et partenaires. « Cette journée, comme il est de tradition, nous ramène à la centralité du migrant dans la gouvernance de la migration », a-t-il déclaré, appelant au partage d’expériences et à des approches innovantes « pour une gestion plus efficace et plus humaine des migrations ». M. Diouf a également évoqué des efforts nationaux concrets visant à mieux accompagner les Sénégalais vivant à l’étranger. Il a rappelé le programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur, lancé la veille lors de la Journée nationale de la diaspora, qui fixe des priorités pour renforcer l’accompagnement, la protection et l’assistance, accroître la contribution de la diaspora au financement du développement et à la valorisation du capital humain, et améliorer la gouvernance ainsi que les cadres institutionnels, en cohérence avec la vision Sénégal 2050 à long terme.Le Coordonnateur résident des Nations Unies au Sénégal, Aminata Maiga, a mis en avant la dimension humaine de la migration ainsi que l’importance de la solidarité et d’approches fondées sur les droits. « La migration n'est pas uniquement une question de chiffres ou de politique publique. Elle est avant tout une expérience humaine, faite de parcours singuliers, de résilience et de contributions multiples à nos sociétés », a-t-elle souligné. Mme Maiga a rappelé comment les Nations Unies accompagnent les pays dans la mise en œuvre des engagements internationaux — notamment à travers le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières et le Réseau des Nations Unies pour la migration, qui contribue à renforcer la coordination et la cohérence au sein du système des Nations Unies et avec les partenaires. Réaffirmant l’engagement des Nations Unies aux côtés des autorités nationales, elle a ajouté : « Ensemble, faisons en sorte que chaque parcours migratoire puisse devenir une histoire de dignité, de contribution et d'espoir. »Aissata Kane, Cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations au Sénégal, avec fonctions de coordination pour le Cap Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, a souligné que le système des Nations Unies travaille avec le Gouvernement et les communautés sur des solutions visant à réduire les risques et à élargir les opportunités — notamment la prévention de la migration irrégulière, les services de protection, ainsi que l’appui au retour et à la réintégration durable, tout en renforçant le lien entre migration, climat et développement et en mobilisant la diaspora comme actrice du développement. « En effet, nous considérons la migration comme un pont entre les cultures, un levier de croissance et une force de transformation sociale », a-t-elle déclaré, en insistant sur l’importance des approches portées par les communautés et la coopération régionale.La société civile et la diaspora au premier planLe programme d’ouverture a donné une place importante aux interventions de la société civile et de représentants de la diaspora, notamment REMIDEV (Réseau migration-développement) et un représentant des migrants, qui ont rappelé le rôle de longue date de la société civile sénégalaise dans la célébration de la Journée internationale des migrants et son utilisation comme espace de mobilisation, de réflexion et de plaidoyer.Les intervenants ont également insisté sur l’importance d’une mise en œuvre inclusive des politiques, d’un engagement communautaire soutenu et d’un accompagnement pratique — en particulier pour les jeunes et les familles — afin de favoriser des choix de mobilité plus sûrs et mieux informés.De la sensibilisation aux solutions — et la culture comme passerelleLa journée a également permis de mettre en lumière des initiatives visant à aider les jeunes à accéder à une information fiable et à identifier des voies plus sûres ainsi que des opportunités locales, notamment WakaWell (wakawell.info) — une plateforme numérique présentée lors de l’ouverture comme un outil d’accompagnement pour une mobilité plus sûre grâce à une information et une orientation accessibles. Des stands d’information et des échanges ont aussi porté sur la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat.En cohérence avec le thème, des prestations culturelles ont rythmé la journée, à commencer par un sketch théâtral mêlant humour et messages directs pour alerter sur les dangers de la migration irrégulière et encourager des choix éclairés, des voies légales et des opportunités au pays, suivi de contributions artistiques d’une délégation venue de Sierra Leone. Suite du programmeÀ la suite de la cérémonie d’ouverture, le programme a comporté un panel de haut niveau sur les migrations, la résilience et le développement, ainsi que des espaces thématiques et des échanges portés par les communautés. Tout au long de la journée, un message commun est ressorti : lorsque la dignité est au cœur des politiques, une migration bien gouvernée peut protéger des vies et devenir une force de développement et de cohésion sociale.
1 / 5

Histoire
24 décembre 2025
United Design : Dakar accueille une exposition photo internationale sur l’avenir de la mode durable
L’Ambassade de Suède à Dakar a inauguré une exposition photo mettant en lumière la contribution de la mode à un avenir durable. Cette exposition, baptisée United Design, vise à faire découvrir aux visiteurs la nouvelle collection d’uniformes destinée aux guides qui accompagnent les visiteurs au siège des Nations Unies à New York — qu’il s’agisse de dirigeants mondiaux ou de groupes scolaires.Depuis 1952, les guides du siège des Nations Unies portent des uniformes spécialement conçus, souvent par de grandes maisons de couture. Aujourd’hui, la Suède et l’École suédoise de textile collaborent avec les Nations Unies pour redéfinir l’avenir de la mode durable. Pour la première fois, des étudiants de l’École suédoise de textile conçoivent ces uniformes emblématiques, marquant un moment charnière dans l’histoire de la mode au siège de l’ONU.L’exposition a été inaugurée le 16 décembre à la résidence de l’ambassadrice de Suède à Dakar, Mme Catharina Cappelin. L’événement s’est déroulé en présence de Mme Aminata Maiga, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Sénégal, ainsi que d’autres responsables onusiens et plusieurs membres du corps diplomatique.Lors de l’ouverture, Mme Catharina Cappelin a rappelé l’importance de cette collaboration pour une « mode respectueuse du climat ». Elle a également souligné que « c’est la première fois que cette exposition est présentée dans un pays francophone », avant d’ajouter que « la Suède demeure un leader mondial de l’innovation durable et cette collection démontre comment la mode peut contribuer à un changement positif ». Mme Aminata Maiga a précisé que la conception de ces uniformes intègre les principes des Objectifs de Développement Durable, en particulier les ODD 5 (Égalité entre les sexes), 8 (Travail décent et croissance économique), 10 (Inégalités réduites), 12 (Consommation et production responsables) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs), à travers des choix concrets :utilisation de matériaux recyclés,sélection de tissus deadstock, c’est-à-dire des tissus excédentaires de haute qualité issus de la surproduction industrielle,techniques de production minimisant l’impact environnemental,valorisation du savoir-faire local.Elle a également ajouté : « Au-delà du design, ces uniformes portent un message : chaque guide devient un ambassadeur de la durabilité, partageant cette histoire avec plus de 200 000 visiteurs chaque année ». Elle a enfin saisi l’occasion pour proposer que « le Système des Nations Unies à Dakar serait honoré d’accueillir cette exposition dans l’un de nos espaces, afin de la partager avec un public plus large — jeunes, artistes, étudiants, partenaires techniques et financiers, et membres de la communauté diplomatique ». Chaque pièce de cette nouvelle collection d’uniformes des guides de l’ONU a été pensée en lien avec les Objectifs de développement durable. Du choix de méthodes de production minimisant l’impact environnemental — comme l’impression numérique du foulard qui réduit la consommation d’eau — à l’utilisation de tissus invendus pour la robe, auxquels on donne une nouvelle vie. Cette collection prouve que les choix durables peuvent être à la fois innovants et élégants. Enfin, certains panneaux photo ont également été exposés lors de la Journée internationale des migrants au Sénégal, le 18 décembre, à l’occasion d’un rassemblement de responsables et de communautés au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, un événement organisé par le Gouvernement du Sénégal et les Nations Unies, avec l’appui de l’Ambassade de Suède.
1 / 5

Histoire
15 décembre 2025
Journée nationale sur la valorisation économique des résultats de la recherche : un tournant pour l’innovation au Sénégal
Dakar, Sénégal – Le 11 décembre 2025, l’Agence Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA) du Ministère de l’Enseignement Superieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), en collaboration avec le Système des Nations Unies au Sénégal, a organisé à l’Hôtel Noom une Journée d’Échanges et de Partenariat sur la Valorisation Économique des Résultats de la Recherche. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de la réforme « Nations Unies 2.0 », qui place la science, la technologie et l’innovation au cœur de l’accélération des Objectifs de Développement Durable (ODD), et dans la vision de l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050, visant à bâtir une économie du savoir inclusive et compétitive.Plus de cent participants – chercheurs, décideurs publics, entrepreneurs, investisseurs, partenaires techniques et financiers – ont répondu présents pour réfléchir aux mécanismes permettant de transformer les résultats scientifiques en impact socio-économique durable.Une ouverture institutionnelle forte et des engagements structurants La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions de Mme Fatimata Diallo, Présidente du Conseil de Surveillance de l’ANRSA, de Dr Lamine Sané, Directeur général de l’ANRSA, de Professeur Mamadou Sarr, Directeur de l’Université Rose Dieng France-Sénégal, représentant des Recteurs, et de Dr Cheikh Tidiane Ba, Chargé de la Gestion des données et du suivi des résultats au sein du Bureau du Coordonnateur Système des Nations Unies. Tous ont insisté sur la nécessité de renforcer les passerelles entre la recherche et le secteur productif pour soutenir la transformation structurelle du pays.« Le constat que nous avons tous fait, c’est qu’à travers nos laboratoires de recherche, à travers nos universités et nos instituts, les chercheurs sénégalais produisent de bons résultats qui peuvent adresser les problèmes locaux », a déclaré le Dr SANÉ.Il poursuit en soulignant l’urgence de la situation : « Le souci maintenant est relatif à la non-application de ces résultats pour résoudre nos propres problèmes. C’est dans ce cadre-là que nous avons co-organisé cette journée avec le système des Nations Unies au Sénégal, pour discuter des méthodologies, des outils et des techniques de financement qui pourront permettre de pouvoir appliquer réellement ces résultats pour le bénéfice des Sénégalais. »Le Pr SARR a mis en avant le rôle des universités dans ce processus : « Le financement de la recherche passera forcément par une stratégie de diversification et de mobilisation des ressources additionnelles pour appuyer l’écosystème de la recherche au sein des universités ».Dr Cheikh Tidiane BA souligne : « Dans l’esprit de la réforme UN 2.0, cette journée marque un tournant : faire de la science et de l’innovation des leviers puissants pour bâtir une économie inclusive, créer des emplois et renforcer la compétitivité nationale, avec l’appui du Système des Nations Unies. »Un moment fort a été la signature de la convention-cadre pour la structuration du Réseau Sénégalais de Valorisation des Résultats de la Recherche (Sen_ReVaRT), qui vise à créer un écosystème national cohérent et orienté vers l’impact. Entre défis et opportunités : une conférence inaugurale structuranteLa conférence inaugurale, modérée par Professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, Directeur de l’Office du Baccalauréat, a été animée par Dr Mor Bakhoum, Secrétaire Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local. Elle a permis de poser les bases des discussions autour des défis majeurs : transfert technologique, financement, partenariats public-privé et rôle de la commande publique dans la promotion des innovations locales.Des panels dynamiques autour des politiques nationales, du financement et des partenariats Le premier panel, intitulé « Politiques nationales et partenariats pour la valorisation », a été modéré par le Professeur Bouba Diop, Président du CAP ANTESRI. Il a réuni plusieurs intervenants de renom : le Professeur Madiagne Diallo (ANSTS), qui a présenté les politiques nationales pour la valorisation économique des résultats de la recherche ; le Dr Dimitri Sanga, Directeur du Bureau Multisectoriel Régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, qui a mis en avant l’appui stratégique du Système des Nations Unies ; Mme Fatou Sagna Sow, CEO de New Deal Consulting et Conseillère Technique au Ministère de la Communication, qui a abordé la question des partenariats pour la valorisation ; le Dr Khadi Nani Dramé, Directrice d’UNIVAL/ISRA, qui a illustré un exemple concret de partenariat entre l’ISRA et APEX ; enfin, le Professeur Amadou Fall (UCAD) a expliqué le processus de création d’entreprises à partir des résultats de la recherche.Le deuxième panel, consacré au « Financement de l’innovation et de la valorisation », a été modéré par le Professeur Soukèye Dia Tine, ancienne Directrice du financement à la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI). Les échanges ont mis en lumière deux axes majeurs : Mme Rokhaya Sall, représentant le Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique (METE), a présenté les opportunités offertes par le financement vert pour soutenir la valorisation, tandis que le Dr Wei Liu, Coordinateur de l’Équipe inter-agences des Nations Unies sur la Science, la Technologie et l’Innovation pour les ODD (IATT), au sein du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), a souligné : « Financer la valorisation n’est pas seulement une question de trouver plus d’argent ; il s’agit d’une allocation de ressources plus intelligente, plus connectée et plus stratégique pour transformer la connaissance en richesse nationale et accélérer les Objectifs de développement durable. »des partenariats stratégiques à l’échelle mondiale.Partage d’expériences et innovations sénégalaises inspirantesDes chercheurs et entrepreneurs ont également présenté des projets particulièrement inspirants, illustrant la créativité et le dynamisme de l’écosystème scientifique national. Le Professeur Michel Bakar Diop a exposé un projet innovant autour du poisson fermenté utilisant des bactéries protectrices, tandis que M. El Hadji Malick Sagne a présenté Cactus Innovation, une initiative axée sur la valorisation durable des ressources locales. Enfin, M. Mamadou Lamine Kebe a mis en avant TOLBI, une solution technologique prometteuse pour l’agriculture. Ces initiatives témoignent de la richesse du potentiel scientifique national et de sa capacité à répondre aux besoins économiques et sociaux.Un engagement renouvelé pour une économie fondée sur la connaissanceEn conclusion, cette rencontre a réaffirmé l’engagement collectif en faveur d’une économie fondée sur la connaissance. Au-delà des échanges techniques, elle a mis en évidence que la valorisation économique de la recherche est un levier stratégique pour créer des emplois de qualité, renforcer la souveraineté technologique, dynamiser les chaînes de valeur nationales et contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, notamment ceux liés à l’éducation, à l’industrie, à l’innovation et aux partenariats. Inscrite dans la vision de l’UNSDCF 2025–2029, qui place la science, la technologie et l’innovation au cœur de la transformation durable du Sénégal, cette journée a permis d’ouvrir un dialogue constructif entre les acteurs clés de l’écosystème. Les résultats attendus – un résumé consolidé des discussions et des recommandations opérationnelles – viendront renforcer les mécanismes de valorisation, structurer les partenariats et améliorer le financement de la recherche appliquée, contribuant ainsi à bâtir une économie compétitive et résiliente.
1 / 5

Publication
30 octobre 2025
L'ONU au Sénégal - Guide rapide
Explorez le Guide Essentiel des Nations Unies au Sénégal
Ce guide rapide met en lumière :Le rôle du Bureau du Coordonnateur résident : garant de la cohérence et de l’efficacité des actions de l’ONU dans le pays.Le Cadre de Coopération des Nations Unies (2024 - 2028) pour le développement durableLes Objectifs de développement durable (ODD) : une feuille de route pour un avenir inclusif et durable.Quelques résultats clés : des avancées concrètes dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la gouvernance et la résilience climatique.Téléchargez la brochure pour découvrir comment l’ONU et ses partenaires contribuent à transformer les engagements en actions au Sénégal.
Ce guide rapide met en lumière :Le rôle du Bureau du Coordonnateur résident : garant de la cohérence et de l’efficacité des actions de l’ONU dans le pays.Le Cadre de Coopération des Nations Unies (2024 - 2028) pour le développement durableLes Objectifs de développement durable (ODD) : une feuille de route pour un avenir inclusif et durable.Quelques résultats clés : des avancées concrètes dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la gouvernance et la résilience climatique.Téléchargez la brochure pour découvrir comment l’ONU et ses partenaires contribuent à transformer les engagements en actions au Sénégal.
1 / 5

Publication
31 octobre 2025
En bref… Résultats de l’ONU en 2024 au Sénégal
Cette brochure présente :Les principales réalisations par Objectif de Développement Durable (ODD) : des avancées concrètes dans la santé, l’éducation, l’égalité des genres, la lutte contre le changement climatique et bien plus encore.Le budget dédié au développement et les ressources mobilisées pour soutenir ces actions et accélérer la mise en œuvre des ODD.Téléchargez la brochure pour explorer comment l’ONU et ses partenaires transforment les engagements en résultats tangibles pour un Sénégal inclusif et durable.
1 / 5

Histoire
24 décembre 2025
Ziguinchor, pôle de la célébration de la Journée des Droits de l'Homme 2025
La Journée internationale des droits de l'homme, traditionnellement observée le 10 décembre, a fait l'objet d'une célébration régionale d'envergure les 10 et 11 décembre 2025 à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Cet événement majeur, qui s'est déroulé sur deux jours, a mobilisé la communauté et les acteurs clés autour du thème : « Les droits de l'homme : nos essentiels de tous les jours ».Coordonnée par la Direction des droits humains (DDH) du Ministère de la Justice, en partenariat avec le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH-WARO), l'initiative a réuni une coalition impressionnante d'acteurs : l'Université Assane Seck, l'incubateur Innov'Zig, les autorités administratives et politiques régionales, ainsi que les organisations locales de la société civile. Avec une participation massive rassemblant plus de 430 personnes, dont 206 femmes, l'assemblée était riche et diversifiée, comprenant des autorités, des forces de sécurité et de défense, des experts, des universitaires, des étudiants, des jeunes et des leaders communautaires.La cérémonie officielle, présidée par l'Adjoint au gouverneur, a bénéficié de la présence du recteur de l'université, du maire, du préfet et du président du conseil départemental.Dans leurs discours, les autorités ont unanimement salué la pertinence de délocaliser cette célébration à Ziguinchor. Elles ont rappelé que la région, marquée par des décennies de conflit, fait face à des défis persistants en matière de droits humains dans un contexte de consolidation de la paix. Le Directeur des droits humains a approfondi ces questions. Le message du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme a également été diffusé, introduit par le point focal géographique du HCDH pour le Sénégal.Le programme était articulé autour de tables rondes thématiques, de débats publics et d'activités communautaires. Les discussions se sont concentrées sur des thèmes cruciaux : l'espace civique et son rétrécissement ; La protection des enfants et les défis associés ; L'engagement des jeunes et la nécessité de renforcer leur participation civique et les migrations internationales et la gestion des risques de traite et de trafic dans les zones frontalières, soulignant l'importance d'une approche de gouvernance fondée sur les droits de l'homme.Un temps fort de cette première journée fut le concours d'éloquence. Devant un large public d'étudiants, les participants ont exposé des arguments convaincants sur des sujets fondamentaux tels que les droits des migrants et la protection des groupes vulnérables, favorisant ainsi une culture du débat civique. La seconde journée a été dédiée à des activités communautaires et des visites de terrain. Les équipes de la DDH et du HCDH, en compagnie des autorités locales, se sont rendues au CEM Kénia, au SOS Village d’Enfants et au Centre des Premier Accueil. Ces visites ont permis non seulement de partager des moments chaleureux avec les enfants, mais aussi de leur offrir des fournitures scolaires, un geste visant à les encourager dans leur participation active à la promotion et à la protection de leurs droits. En définitive, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme à Ziguinchor a atteint son objectif : sensibiliser la communauté, dynamiser l'engagement des jeunes et consolider la collaboration entre les institutions, la société civile et les partenaires locaux. L'événement a permis de définir clairement les priorités régionales en matière de droits humains en Casamance, tout en renforçant l'ancrage d'une culture civique basée sur les droits fondamentaux dans toute la région.
1 / 5

Histoire
24 décembre 2025
Visite officielle : ONU-Habitat et le Sénégal renforcent leur partenariat pour un développement durable et inclusif
Lors d’une visite officielle au Sénégal, Ana Claudia Rossbach, Directrice exécutive d’ONU-Habitat, a marqué une étape importante dans la coopération entre l’organisation et les autorités sénégalaises. Le 5 décembre à Dakar, en présence du ministre de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire et des Collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, a été lancée la Plateforme de partenariat pour la localisation des Objectifs de développement durable (ODD). Cet outil stratégique accompagnera la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050 et des réformes territoriales, en s’appuyant sur les données et les dynamiques locales pour accélérer l’atteinte des ODD. Ana Claudia Rossbach a souligné l’importance de renforcer la planification urbaine et la gouvernance locale afin de répondre aux défis liés à l’urbanisation rapide, à la mobilité et à la résilience des territoires. Elle a insisté sur la nécessité d’une approche inclusive et durable, intégrant les collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.« Nous devons faire en sorte qu’au niveau mondial, le processus d’urbanisation marche pour les personnes et pour l’environnement », a déclaré Ana Claudia Rossbach, rappelant l’urgence d’agir pour des villes durables et résilientes. Dans le cadre de cette mission, une visite a également été effectuée dans la commune de l’île de Gorée, où la délégation a rencontré le maire de Gorée, Me Augustin Senghor, et les membres du Conseil municipal. Les échanges ont porté sur les pistes de collaboration entre ONU-Habitat et la commune, notamment en matière d’assainissement, de protection du littoral, de sauvegarde du patrimoine bâti et de mobilité. Les autorités locales ont présenté les défis auxquels la commune reste confrontée, tandis qu’Ana Claudia Rossbach a réaffirmé l’engagement d’ONU-Habitat à soutenir les collectivités à forte valeur historique et environnementale. Me Augustin Senghor a salué cette initiative, mettant en avant l’importance d’un partenariat durable pour le développement harmonieux de l’île et le bien-être de ses habitants.Ces rencontres illustrent la volonté commune de promouvoir des villes et des territoires inclusifs, résilients et durables, conformément aux objectifs de l’Agenda 2030.
1 / 5

Histoire
08 décembre 2025
Table ronde nationale sur la dette publique : le Sénégal explore des solutions durables pour financer les droits humains et le développement
Dakar, 2 décembre 2025 – Le Système des Nations Unies au Sénégal, en collaboration avec le Gouvernement du Sénégal et plusieurs partenaires techniques et financiers, a organisé le mardi 02 décembre 2025 une table ronde de haut niveau consacrée à la gestion et la gouvernance de la dette publique au service des droits humains et du développement durable. La rencontre, tenue à l’Hôtel Noom, a réuni plus d’une cinquantaine de participants en ligne et en présentiel dont des représentants du Gouvernement, des agences onusiennes, des institutions financières internationales, de la société civile, du monde académique et du corps diplomatique.Co-organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Bureau du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le PNUD, l’UNICEF et ActionAid Sénégal, l’évènement intervient dans un contexte marqué par des défis budgétaires majeurs et une pression accrue sur les finances publiques. Ces enjeux, aggravés par des facteurs externes – crise sanitaire, instabilité des marchés mondiaux, tensions géopolitiques – et internes, exigent une approche intégrée où la gestion de la dette s’aligne sur les droits humains, les Objectifs de développement durable (ODD) et les engagements climatiques. Un contexte exigeant pour les finances publiquesDepuis 2024, le Sénégal fait face à un déficit budgétaire et un niveau d’endettement plus élevés que prévu, provoquant un gel de ses engagements avec ses partenaires multilatéraux, dont le FMI. Pour répondre à la situation, le Gouvernement a annoncé un plan de relance économique et sociale le 1er août 2025, fondé sur trois piliers : réduction des dépenses, mobilisation des ressources intérieures et recherche de financements alternatifs.Si cette stratégie vise à renforcer la gestion des finances publiques et créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales essentielles, elle suscite aussi des inquiétudes quant à l’impact potentiel de mesures d’austérité sur les droits économiques et sociaux, notamment pour les groupes vulnérables.Des échanges au plus haut niveauLa cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Robert Kotchani, Représentant régional du HCDH, intervenant au nom de Mme Aminata Maïga, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Sénégal, aux côtés de Mme Fatimata Ly, représentante de Dr Alioune Diouf, Directeur de la Dette publique du Ministère des Finances et du Budget. Les échanges qui ont suivi se sont articulés autour de quatre grands axes : les défis fiscaux et d’endettement pour un développement centré sur les personnes ; l’alignement de la gestion de la dette sur les droits humains et le développement durable ; la transparence, la gouvernance et la redevabilité dans la gestion de la dette ; ainsi que les réformes de l’architecture financière internationale et les enseignements pouvant être tirés du contexte sénégalais.Les échanges ont mis en lumière la nécessité d’une approche holistique, combinant réformes structurelles, lutte contre les flux financiers illicites, renforcement du contrôle parlementaire et promotion de mécanismes de financement innovants compatibles avec la viabilité de la dette.La dette publique comme levier – ou obstacle – aux droits humainsLes participants ont rappelé que la dette publique peut constituer un véritable levier de progrès lorsqu’elle est gérée de manière stratégique, mais qu’elle devient un frein au développement lorsque le service de la dette réduit l’espace budgétaire consacré à la santé, à l’éducation, à l’emploi ou à la protection sociale. Ils ont ainsi insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources internes — notamment à travers une fiscalité plus progressive —, d’intensifier la lutte contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites, et de consolider la transparence budgétaire, jugée encore insuffisante au regard des résultats de l’enquête sur le budget ouvert de 2024. Les intervenants ont également souligné l’importance d’aligner les décisions d’endettement sur les engagements du Sénégal en matière de droits humains et d’Objectifs de développement durable, tout en appelant à une évaluation rigoureuse des instruments de financement innovants tels que les obligations vertes ou les obligations ODD, afin d’en garantir la pertinence et la viabilité.Vers une économie fondée sur les droits humainsCette rencontre nationale s’inscrit dans la continuité de la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement (FdD4) et de l’Engagement de Séville, qui appellent à une réforme ambitieuse et structurelle de l’architecture financière internationale. Pour le Sénégal, la table ronde a offert une plateforme stratégique permettant d’approfondir le dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires, de renforcer les capacités nationales en matière de gouvernance de la dette, d’éclairer les réformes économiques en cours et de consolider les approches visant à préserver l’espace budgétaire indispensable aux dépenses sociales essentielles. Des résultats attendus et un engagement renouvelé du Système des Nations UniesLa rencontre devrait aboutir à deux résultats majeurs : la production d’un résumé officiel des échanges, diffusé par les organisateurs, et l’élaboration de recommandations opérationnelles destinées à mieux aligner la gestion de la dette sur les droits humains et les objectifs de développement durable. Au-delà de ces livrables, la table ronde consacre également un engagement renouvelé du Système des Nations Unies à accompagner le Sénégal dans sa transition vers une économie fondée sur les droits humains, en soutien aux ambitions nationales portées par la Vision Sénégal 2050, l’Agenda 2030 et le UNSDCF 2025–2029.
1 / 5

Histoire
05 décembre 2025
Visite officielle : ONU Femmes renforce son engagement pour l’égalité et l’autonomisation des femmes au Sénégal
Dakar, Sénégal - Le 1er décembre 2025, à l’occasion de sa visite officielle au Sénégal, Madame Nyaradzayi Gumbonzvanda, Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes, a rencontré l’équipe pays des Nations Unies au Sénégal pour échanger sur le soutien aux priorités nationales et le positionnement stratégique d’ONU Femmes en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Cette rencontre, organisée à l’hôtel Noom à Dakar, s’est tenue en présence du Coordonnateur résident ai et des membres de l'équipe pays des Nations Unies au Sénégal. Les discussions ont porté sur la contribution du système des Nations Unies à la mise en œuvre des engagements du Sénégal en matière de développement durable, notamment l’Agenda 2030, Beijing +30, la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que l’initiative UN80 visant à renforcer l’impact collectif des Nations Unies à l’occasion de son 80e anniversaire. Elle a également été l’opportunité pour l’équipe pays de présenter ses initiatives, projets et programmes en faveur de l’égalité des genres et de réaffirmer son engagement à en faire une composante intégrante dans leur conception et formulation.Madame Gumbonzvanda a également participé à un dialogue avec des femmes et des jeunes leaders du Sénégal et du Sahel, afin de promouvoir le leadership féminin et renforcer la voix des femmes dans les processus décisionnels. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, soulignant l’importance de la mobilisation collective pour mettre fin à ces violences.À l’issue des échanges, Madame Nyaradzayi Gumbonzvanda a souligné l’importance d’une coordination renforcée et a adressé un message mobilisateur :« Dans le contexte de l’initiative UN80, il est essentiel de renforcer notre coordination pour maximiser l’impact collectif des Nations Unies. Je souhaite à toutes et à tous de fructueux 16 jours d’activisme et vous invite à contribuer activement à la campagne contre la violence en ligne ciblant les femmes. Ensemble, nous pouvons créer un espace numérique sûr et inclusif. »
— Nyaradzayi Gumbonzvanda, Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes En marge de cette rencontre, la Directrice exécutive adjointe a réaffirmé l’engagement d’ONU Femmes à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales, les partenaires au développement et la société civile pour faire progresser les droits des femmes et des filles, et bâtir une société plus inclusive et équitable.
— Nyaradzayi Gumbonzvanda, Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes En marge de cette rencontre, la Directrice exécutive adjointe a réaffirmé l’engagement d’ONU Femmes à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales, les partenaires au développement et la société civile pour faire progresser les droits des femmes et des filles, et bâtir une société plus inclusive et équitable.
1 / 5

Histoire
26 novembre 2025
Le Sénégal lance les 16 jours d’activisme à Gorée sous le thème « Mettre fin aux violences numériques »
Île de Gorée, Sénégal, 25 novembre 2025 — Le Sénégal a officiellement lancé l’édition 2025 des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre à Gorée, en mettant l’accent sur la violence numérique contre les femmes et les filles sous le thème « Mettre fin aux violences numériques ». La cérémonie nationale, présidée par Maïmouna Dièye, Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, a réuni des institutions gouvernementales, ONU Femmes et d’autres entités des Nations Unies, des partenaires diplomatiques, des représentantes et représentants de la société civile et des jeunes, les intervenantes et intervenants appelant à une prévention plus forte, au signalement, au soutien aux survivantes et aux survivants, et à la redevabilité en ligne.Dans son discours de lancement, la Ministre Dièye a mis en lumière l’ampleur des abus en ligne et la nécessité de veiller à ce que les espaces numériques fassent avancer l’égalité plutôt que de nuire. « La prévalence des violences numériques subies avant l’âge de 18 ans est de 20,4%. », a-t-elle déclaré.« L’utilisation abusive des réseaux sociaux par la désinformation, la diffamation, le harcèlement, l’usage de données personnelles sans consentement, la menace et le dénigrement constituent pour les femmes et les filles une lourde menace et les exposent à de lourdes conséquences, notamment par rapport à leur santé mentale. Mesdames et Messieurs, le numérique doit être un espace d’émancipation, pas une nouvelle frontière de la violence. » Message de l’ONU : action urgente, collective et soutien en coursS’exprimant au nom du Coordonnateur résident du système des Nations Unies, Aminata Maiga, Arlette Mvondo, Représentante de ONU Femmes au Sénégal, a averti que la violence numérique s’étend rapidement, prenant des formes qui endommagent des vies bien au-delà de l’écran.« À travers le monde, la violence numérique progresse à une vitesse inquiétante. Elle prend des formes nouvelles, les deepfakes, diffusion non consentie d’images intimes, harcèlement, manipulation, menaces, chantage, autant de violences qui brisent des vies bien au-delà des écrans. »En se référant à des cas récents évoqués pendant la cérémonie, elle a souligné l’ampleur de la menace qui vise les femmes et les filles en ligne. « L’actualité récente sur la cybercriminalité au Sénégal a révélé une réalité glaçante sur les violences en ligne dont 60% des victimes ont été des femmes et des filles. Cette statistique dit tout. Elle dit l’insécurité, la vulnérabilité des femmes. Elle dit l’ampleur du traumatisme, de la peur. Elle dit également l’urgence d’agir et d’agir ensemble. »Mme Mvondo a aussi mis en lumière la manière dont le système des Nations Unies soutient les efforts du Sénégal pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre, y compris à travers des programmes conjoints alignés sur le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Elle a cité des initiatives pour renforcer les services et la protection des survivantes et des survivants, élargir l’accès à la justice et aux recours, et protéger les filles contre les pratiques néfastes, y compris les programmes conjoints Thiendeya et Karangue, le programme e-justice pour soutenir la numérisation de la justice, et le plan conjoint qui traite les mutilations génitales féminines, mis en œuvre avec des partenaires nationaux.Voix des jeunes : « La violence numérique n’est pas virtuelle, elle est réelle »Un moment central de la cérémonie a été l’intervention de Adja Gaita Ndour, Représentante des jeunes et Ambassadrice de l’Agenda national de la fille, qui a exhorté les dirigeantes et dirigeants et les communautés à affronter la manière dont les abus numériques réduisent les filles au silence et normalisent le mal. « Nous prononçons si souvent l’expression « violence basée sur le genre » qu’elle peut finir par s’éviter de son sens. » a-t-elle observé. « Alors aujourd’hui, permettez-moi de commencer par ce qu’elle signifie réellement. »Elle a souligné que les dommages causés en ligne ne sont pas abstraits. « La violence numérique n’est pas virtuelle, elle est réelle. Elles blessent, elles isolent, elles humilient, elles réduisent en silence. »Perspective des partenaires : prévention, réponse et soutien pratiqueHélène De Bock, Ambassadrice de Belgique au Sénégal, a souligné que la violence basée sur le genre, y compris dans les espaces numériques, est un défi mondial partagé qui exige des réponses coordonnées. « Cette campagne est lancée partout au monde aujourd’hui parce que la violence basée sur le genre nous concerne tous, surtout dans un monde de plus en plus numérisé où les frontières n’existent plus. »Elle a également indiqué le soutien de la Belgique pour renforcer la prévention et la réponse, y compris l’appui à des services holistiques pour les survivantes et survivants, des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités pendant la période de la campagne, et l’engagement avec des acteurs clés tels que les journalistes, des parties prenantes communautaires et les forces de sécurité.Gorée : mémoire, dignité et appel à l’action aujourd’hui Le lancement a eu lieu à Gorée après un moment symbolique de recueillement lié à l’histoire de l’île, y compris une visite et un recueillement à la Maison des Esclaves et à la Porte du Non-Retour, longtemps associée à la traite transatlantique et à la déshumanisation d’innombrables personnes.La Ministre Dièye a expliqué que le choix de Gorée était délibéré : il visait à relier la violence systémique et la déshumanisation du passé à de nouvelles formes de domination et d’exclusion à l’ère du numérique, et à souligner que la protection de la dignité doit s’étendre des espaces physiques aux espaces virtuels. À Gorée, a-t-elle dit, la mémoire n’est pas seulement le fait de rappeler les souffrances, mais aussi celui de tirer des leçons qui renforcent la liberté, la dignité et la protection aujourd’hui.Le programme a également comporté une présentation thématique sur les formes de violence numérique, une prestation théâtrale et des échanges avec les participantes et participants, renforçant le message selon lequel mettre fin aux abus en ligne exige sensibilisation, signalement, protection et redevabilité.Reconnaître la santé mentale et la mobilisation communautaireLa cérémonie a aussi mis en lumière l’impact sur la santé mentale de la violence numérique. Fatou Diop, fondatrice de l’initiative Weeruwaay, a souligné que les abus en ligne peuvent causer des dommages psychologiques graves et que le bien-être et le soutien doivent être centraux dans les réponses. « Bien qu’invisible physiquement, ces agressions causent des traumatismes psychologiques réels et durables. » a-t-elle déclaré, ajoutant : « La santé mentale, c’est une urgence aujourd’hui. Parce que sans une bonne santé mentale, il n’y a pas de santé. »Participants notablesLa cérémonie a réuni plusieurs personnalités nationales et internationales, notamment :Marie Hélène Diouf, Membre du ParlementAmsatou Sow Sidibé, Présidente de la Commission nationale des Droits de l’HommeAugustin Senghor, Maire de GoréeCarine Robarts, Ambassadrice de Grande-BretagneJean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au SénégalClaudia Mosquera Rosero-Labbé, Ambassadrice de ColombiePenda Seck Diouf, Présidente de la Synergie des organisations de la société civileNdeye Marième Samb, Coordonnatrice nationale, Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA)Poursuite de la campagne à l’échelle nationaleLes 16 jours d’activisme se poursuivront à travers le Sénégal sous le thème « Mettre fin aux violences numériques » jusqu’au 10 décembre, avec un programme national de sensibilisation, de prévention et d’action coordonnée mobilisant institutions, communautés, partenaires, médias et jeunes afin d’aider à faire en sorte que les espaces numériques protègent les droits, la sécurité et la participation des femmes et des filles, plutôt que de permettre des préjudices. Comment participer à la campagne? Créez une carte numérique avec votre photo et votre message, et à afficher votre soutien en utilisant notre cadre dédié : 1️⃣ Cliquez sur le lien : https://twb.nz/16joursunwsen2️⃣ Téléchargez votre photo3️⃣ Placez-la dans le cadre4️⃣ Téléchargez l’image finale➡️ Vous pouvez ensuite l’utiliser comme photo de profil ou la partager sur vos réseaux sociaux pour amplifier la campagne.Ensemble, faisons entendre nos voix et créons des espaces – physiques comme numériques – où chaque femme et chaque fille peut s’exprimer librement et en toute sécurité.
1 / 5

Communiqué de presse
09 octobre 2023
Les Conseils d’administration de six agences des Nations Unies se rendent au Sénégal pour constater les résultats conjoints atteints en appui au Gouvernement
Au cours de la visite, la délégation a rencontré des autorités de haut niveau, des responsables municipales, des représentants de la société civile, du secteur privé, des communautés locales et des jeunes. Une réunion inaugurale avec la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Mme Aminata Maiga, et l'équipe de pays des Nations Unies, a permis de saisir le travail des Nations Unies dans son ensemble, ainsi que celui des six entités en particulier, et des expertises respectives disponibles pour soutenir le pays à progresser vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable.
Au cours de la réunion, et ultérieurement pendant la visite, la délégation a pris connaissance de la perspective régionale, incluant les défis et les opportunités, lors des discussions avec la Stratégie des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, les directeurs régionaux des agences des Nations Unies et le Bureau de coopération au développement.
Au cours de la semaine, la délégation a rencontré M. Amadou Ba, Premier ministre, Mme Aïssata Tall Sall, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mme Oulimata Sarr, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’action sociale et d'autres hauts responsables. Le Premier Ministre a exprimé sa gratitude pour le soutien des Nations Unies et a salué la qualité du travail réalisé par toutes ses entités au Sénégal. Il a rappelé par ailleurs, l’attachement de longue date du Sénégal au multilatéralisme et l’importance accordée à la coopération avec les Nations Unies.
La délégation s'est également rendue à Diamniadio, où ses membres ont visité la nouvelle Maison des Nations Unies, initiée et financée par le gouvernement du Sénégal. Ce bâtiment est destiné à regrouper toutes les entités des Nations Unies présentes au Sénégal, pour un effectif d’environ 2.400 employés. La Maison des Nations Unies est très emblématique de la réforme d’efficacité des Nations Unies et de l’esprit de la réforme globale portée par le Secrétaire général Antonio Guterres, pour optimiser l’efficacité dans les interventions au service des populations.
La délégation a été divisée en différents groupes qui se sont rendus sur le terrain pour avoir un aperçu direct de l'impact des interventions soutenues conjointement par les agences sur les communautés bénéficiaires, ainsi que pour comprendre comment ces dernières remplissent leurs mandats respectifs, tout en créant les synergies nécessaires pour accroître l'efficacité de leurs interventions. Dans les régions de Dakar et de Thiès, les membres de la délégation ont visité plusieurs projets et programmes, notamment ceux axés sur la promotion de l'autonomisation des femmes, la résilience des groupes vulnérables, l'accès à la justice, le renforcement de l'utilisation des données, l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat et la collaboration avec le secteur privé.
D'autres membres de la délégation se sont rendus dans la région sud de la Casamance, où ils ont visité des initiatives communautaires innovantes soutenues par les agences des Nations Unies visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines, à améliorer la santé des adolescents, des mères et des enfants, à autonomiser et sensibiliser les jeunes, à améliorer l'accès et la qualité des services de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, et à promouvoir l'alimentation scolaire pour soutenir les efforts du pays en faveur d’une éducation inclusive et de qualité.
À l'issue de cette visite, la délégation a exprimé sa satisfaction d’avoir eu l’occasion de mieux comprendre la coordination inter-agences des Nations Unies au Sénégal et sa contribution à la réalisation des objectifs de développement du pays.
1 / 5
Communiqué de presse
21 septembre 2023
Le Sénégal répond à l'appel du Sommet des Objectifs de Développement Durable sous la direction éclairée du Président Macky Sall
Le Système des Nations Unies au Sénégal est fier d’avoir organisé une concertation nationale, en collaboration avec le gouvernement, pour préparer la participation du Sénégal à ce Sommet sur les Objectifs de Développement Durable.
Dans son discours éloquent lors de la clôture du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres a salué l’engagement des dirigeants présents. Il a appelé à traduire les engagements pris au cours de ce sommet en actions concrètes et a formulé des recommandations cruciales pour les prochaines étapes.
Le Secrétaire général a identifié sept domaines clés dans lesquels les pays peuvent concentrer leurs efforts pour accélérer les progrès vers les ODD :
Investissements réels pour le Développement Durable : Transformer le soutien financier en investissements concrets dans les pays en développement, visant à atteindre au moins 500 milliards de dollars par an pour le développement durable.
Mise en œuvre des engagements : Traduire les engagements pris lors du sommet en politiques concrètes, budgets, portefeuilles d'investissement et actions tangibles, tout en renforçant la responsabilité et en suivant les progrès grâce à des revues nationales volontaires.
Soutien aux transitions clés : Renforcer le soutien aux actions dans six domaines clés de transition vers les ODD : alimentation, énergie, numérisation, éducation, protection sociale et emplois, et biodiversité.
Investissements massifs dans la protection sociale : Planifier dès maintenant des augmentations massives des investissements dans la protection sociale pour couvrir un milliard de personnes supplémentaires d'ici 2025 et quatre milliards d'ici 2030.
Atteinte de l'objectif d'aide publique au développement : Il est temps pour les pays développés d'atteindre l'objectif de 0,7 % du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement.
Réformes financières mondiales : Appeler à des réformes dans le système financier mondial pour mieux répondre aux besoins des pays en développement, incluant la réorientation urgente de 100 dollars en Droits de tirage spéciaux (DTS) inutilisés et la mobilisation de financements privés.
Action concrète pour le climat : Présenter des plans et propositions concrets à la COP28 pour éviter les pires effets du changement climatique, tenir les promesses mondiales d'un soutien essentiel et aider les pays en développement à réussir une transition juste et équitable vers les énergies renouvelables.
Le Système des Nations Unies au Sénégal salue l'engagement du Sénégal dans la réalisation des ODD et réitère sa disponibilité à apporter son appui dans la mise en œuvre des recommandations du Secrétaire général. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur, plus sain, plus paisible, plus durable et plus prospère pour tous.
1 / 5
Communiqué de presse
25 mai 2023
Les ambassadeurs africains appellent à une mise en œuvre accélérée de la Zone de libre-échange continentale africaine et du Marché unique du transport aérien en Afrique
Cette table ronde, qui s’inscrit dans le cadre de la Série de séminaires de l’IDEP sur le développement, est une contribution de l’Institut à la Journée de l’Afrique célébrée chaque année le 25 mai et qui coïncide cette année avec le 60ème anniversaire de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) devenue Union Africaine (UA), sous le slogan « Notre Afrique notre future ». Cet anniversaire coïncide aussi avec les 60 ans d’existence de l’IDEP célébrée en 2023.
Le thème de cette année s’accorde aussi parfaitement avec le thème de l'année 2023 de l'Union africaine qui est « L'année de la ZLECAf : accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine ». Ce thème vise à susciter un plus grand engagement politique en faveur du commerce en tant que programme de développement pour l'Afrique. Il servira à mobiliser des solutions et la solidarité pour transformer cette vision en réalité, en vue de créer des liens avec les États membres, les organes de l'UA, les acteurs du secteur privé, les partenaires du développement et d'autres parties prenantes, qui ont des rôles importants à jouer pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf.
«La ZLECAf et le MUTAA sont liés et se renforcent mutuellement. La ZLECAf a entre autres objectifs spécifiques de contribuer à la circulation des capitaux et des personnes et de faciliter les investissements. Un fonctionnement efficace du MUTAA, quant à lui, permettrait aux habitants de la région de gagner en confort et en choix de compagnies aériennes, de réduire les temps de vol, d'opportunités d'affaires et de renforcer les liens culturels par le développement progressif du tourisme d'affaires et de loisirs », a souligné Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice de l’IDEP.
Aminata Maiga, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Sénégal a salué la collaboration en cours entre l’IDEP et les ambassadeurs du Groupe africain. « Les objectifs de l’Union Africaine sont en droite ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). La mise en œuvre réussie de la ZLECAf nécessite une coordination étroite entre les Nations unies, l’Union africaine et les pays afin de garantir des politiques commerciales bénéfiques et durables ». Elle en outre déclaré que « Les Nations Unies continueront à se tenir aux côtés des peuples, des Nations et des Organisations régionales et continentales pour construire une Afrique prospère ».
« Il est inimaginable qu’on continue à avoir ces grandes difficultés pour passer d’une capitale à une autre en Afrique. Il y a un travail extraordinaire qui est fait à l’Union africaine et il serait temps que les diplomates s’approprient la ZLECAf et le MUTAA, deux problématiques étroitement liées et fondamentales pour notre continents », a relevé S. E. Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, Ambassadeur de la République du Gabon, Doyen du groupe africain des ambassadeurs au Sénégal.
Le séminaire a vu les communications de S. E. Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf, d’Angeline Simana, Directrice du Transport aérien de la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), de Prosper Zo'o Minto'o, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de Jason MC Cormack, Chargé des affaires économiques à la Commission économique pour l’Afrique (CEA).
« Il y a beaucoup d’obstacles mais la ZLECAf offre des opportunités vers la création d’un marché unique en Afrique. Nous avons établi trois protocoles sur l’investissement, la concurrence et la propriété intellectuelle qui sont des piliers dans la mise œuvre et tout cela ne serait pas possible sans les partenaires qui se sont engagé à appuyer la ZLECAf afin que nous allions au-delà des accords commerciaux », a déclaré Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf.
La ZLECAf et le MUTAA sont deux des projets phares de l’Agenda 2063 et s’inscrivent dans la perspective historique du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine. L’accord de la ZLECAf est entré en vigueur en 2019 et la mise en œuvre a commencé en 2021. Tandis que la Déclaration sur la création d’un MUTAA a été adoptée en janvier 2015 et le lancement officiel effectué en janvier 2018.
L’objectif de la ZLECAf, est de créer un marché continental unique pour les biens et services, avec une libre circulation des personnes et des opportunités d’investissements, tout en améliorant la compétitivité et en soutenant la transformation économique. La ZLECAf représente une avancée effective en matière d’intégration régionale, d’industrialisation, de développement des échanges commerciaux et de transformation structurelle dans le continent.
Selon des estimations récentes de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies, la ZLECAf devrait accroître le commerce intra-africain de services de transport de près de 50 %. En valeurs absolues, il est indiqué qu’avec une ZLECAf, plus de 25 % des gains commerciaux africains dans le domaine des services du commerce intra-africain iraient uniquement au transport et près de 40 % de l’augmentation de la production de services en Afrique concernerait les transports.
A l’instar de la ZLECAf, le MUTAA, regorgerait de plusieurs avantages à même de renforcer la connectivité entre les États et entre les régions. Selon l’Association du Transport Aérien International (IATA), à ce jour, 34 pays ont adhéré au MUTAA, représentant 80% du marché de l’aviation existant en Afrique.
En plus de l’augmentation prévue des fréquences à hauteur de 27% sur les routes aériennes existantes, le MUTAA permettrait par ailleurs la réalisation d’économies d’échelle d’environ 500 millions de dollars en tarifs passagers, la libre concurrence, l’ouverture de nouvelles liaisons commerciales et la protection de l’environnement, et le développement du secteur privé de l’aviation civile.
Pour l’IDEP et les diplomates de ses Etats membres, cette table ronde, qui a réuni des fonctionnaires de haut-niveau, des décideurs politiques, des chercheurs et des représentants d’organisations internationales, était une occasion de réfléchir sur les enjeux et les défis auxquels fait face notre continent en matière de développement.
A l'issue des échanges, les ambassadeurs ont appelé les pays à faire preuve de plus d'engagement pour lever les barrières existantes dans la mise en œuvre des deux projets. Une approche régionale est nécessaire pour sensibiliser et soutenir les États non performants. Le rôle du secteur privé et de la société civile a été jugé nécessaire pour l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf et du MUTAA.
Publié par :
Institut Africain de Développement Economique et de Planification
Rue du 18 juin (derrière l’Assemblé nationale)
Dakar
Sénégal
Tel.: (+221) 33 829 55 00 / 33 829 55 27
Web : www.uneca.org/idep
1 / 5
Communiqué de presse
07 mars 2023
Les Nations Unies saluent les efforts et appellent à une mobilisation accrue pour la protection de l’enfant au Sénégal
En visite officielle au Sénégal entre le 23 février et le 1er mars 2023, Dr. Najat Maalla M’jid a pu rencontrer au plus haut niveau les autorités nationales, ainsi que les autorités locales y compris les représentants des Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE) de Guédiawaye et de Saint Louis, le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, l’équipe pays des Nations unies, les partenaires au développement, la société civile, les chefs religieux, les enfants et les jeunes. Elle a également pu visiter la maison d’arrêt pour mineurs de Hann.
Elle a pu ainsi saluer les avancées réalisées par le pays et notamment la réforme en cours pour offrir à chaque enfant un environnement protecteur et favorable à son épanouissement.
Le Gouvernement Sénégalais a dans son Plan Sénégal Emergent aligné ses objectifs de développement avec les Agenda 2030 et 2063. "Nous espérons que la protection de l’enfant sera davantage renforcée dans le cadre de l’élaboration actuelle du nouveau Programme d’Action Prioritaire du Gouvernement" a indiqué Dr. Najat Maalla M’jid. "L'ancrage institutionnel de la protection de l’enfant au niveau national présente une opportunité avec la nouvelle primature de faire de la protection de l’enfance une question prioritaire et transversale du Gouvernement ".
"La proportion du budget de l’état consacré à la protection de l'enfant, actuellement de 0,05%, pourrait être augmenté en lien avec les engagements pris dans le cadre de la Politique de la CEDEAO pour l’Enfance (2019- 2030) qui propose un objectif de 3%."
"Mettre fin à la violence contre les enfants offre la possibilité de générer d’importants dividendes sociaux et économiques. Cela supprimerait un obstacle majeur qui empêche les enfants d’atteindre leur plein potentiel de développement et pourrait réduire les coûts pour les sociétés. Il est crucial d’augmenter les ressources publiques destinées à la protection de l’enfant" a-t-elle ajouté.
La Représentante Spéciale a par ailleurs souligné l’importance de l’accès à l’ensemble de la chaîne de services pour les plus vulnérables et particulièrement les enfants, en mettant un accent particulier sur l’accès à la justice pour les enfants, un défi qui nécessite l’engagement de tous les secteurs.
"La résolution du gouvernement de moderniser et d’intégrer les daaras dans le système éducatif formel, avec des standards de qualité, représente une porte d’entrée pour la protection des enfants au Sénégal. Dans ce processus, le rôle des maîtres coraniques et des communautés en tant que parties prenantes est crucial" a-t-elle suggéré.
La visite de la Représentante spéciale a permis de faire un état des lieux de la situation des enfants et de leur protection au Sénégal. Elle a ainsi pu redynamiser les énergies et les soutiens politiques pour entretenir l’élan auprès des différents acteurs autour d’un même objectif et d’éveiller les consciences à propos des effets néfastes de la violence sur les enfants, pour promouvoir des changements sociaux et comportementaux, ainsi que pour que de réels progrès soient accomplis dans ce domaine.
Notes aux éditeurs
Au Sénégal, le système des Nations Unies, à travers le groupe de travail sur la protection des enfants dont l’UNICEF assure le lead, soutient le Gouvernement dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des stratégies, politiques et plans nationaux de protection de l’enfant, dans le renforcement des services des secteurs de l’action sociale, de la justice, de la santé, et de l’éducation pour prévenir, détecter, et répondre aux cas de violence, exploitation, pratiques néfastes, ainsi que le renforcement des compétences des enfants, parents et communautés.
Pour des informations supplémentaires :
Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira, Communication et Plaidoyer, Bureau du Coordinateur Résident, +221 77 462 29 28, papa.sakhojimbira@un.org, Système des Nations Unies au Sénégal
Moussa Diop, Spécialiste de la Communication, UNICEF, +221 77 644 33 22, modiop@unicef.org
Miguel Caldeira, Communication Officer, Office of the Special Representative on Violence against Children, email: caldeira1@un.org
1 / 5
Communiqué de presse
23 février 2023
La Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants en visite officielle au Sénégal pour soutenir les efforts en faveur la protection de l’enfant
La Représentante spéciale du Secrétaire General des Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, Dr. Najat Maalla M’jid, effectuera une visite officielle au Sénégal du jeudi 23 février au mercredi 1er mars 2023. Cette visite sera ponctuée par des séries de rencontres officielles avec les plus hautes autorités du Gouvernement, l’équipe pays des Nations Unies, la société civile, les enfants, et des visites sur le terrain avec un large éventail de parties prenantes de la protection de l’enfance.
A l’instar des précédentes missions dans d’autres pays, cette visite permettra à la Représentante spéciale de constater de visu les progrès réalisés dans la protection des enfants contre la violence au Sénégal et les efforts entrepris par le gouvernement pour surmonter les défis qui subsistent. La Représentante rencontrera des enfants, des adolescent/e/s et des leaders et intervenants au niveau communautaire pour recueillir leurs perspectives et mieux apprécier les raisons de la persistance de certaines pratiques néfastes à l’épanouissement des enfants.
Le Sénégal a réalisé d’importants progrès au cours des dernières années pour que chaque enfant vive à l’abri de toutes les formes de violences, y compris l’exploitation et les pratiques néfastes.
Malgré ces récents développements, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer le système national de protection de l’enfant, créer un environnement de soutien et de protection pour chaque enfant indépendamment de leur statut et dans tous les contextes. Il est ainsi nécessaire d’appréhender les Objectif de Développement Durable dans leur ensemble car ils touchent de près ou de loin au bien-être de l’enfant.
Cette visite sera une occasion de mobiliser les énergies et les soutiens politiques nécessaires en vue d’une approche intégrée et inclusive de la protection de l’enfance en vue de mettre en exergue les bonnes pratiques et accélérer les progrès accomplis pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants au Sénégal.
La Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé la nomination de Najat Maalla M’jid, du Maroc, le 30 mai 2019 en tant que son Représentant spécial chargé de la question sur la violence contre les enfants au niveau de Sous-Secrétaire générale. Dr. M’jid est un médecin pédiatre qui a consacré les trois dernières décennies de sa vie à la promotion et à la protection des droits de l’enfant. Elle a été Chef du Département de pédiatrie et Directrice de l’hôpital Hay Hassani pour la mère et l’enfant à Casablanca. Lire la suite
La Représentante spéciale joue le rôle de défenseur mondial indépendant chargé de promouvoir la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence visant les enfants. Elle assure des fonctions de médiation et de facilitation des activités dans toutes les régions et dans tous les milieux et domaines où les enfants sont susceptibles d’être victimes de violence. Elle mobilise les énergies et les soutiens politiques pour entretenir l’élan autour de l’objectif poursuivi et réveiller les consciences à propos des effets néfastes de la violence sur les enfants, pour promouvoir des changements sociaux et comportementaux, ainsi que pour que de réels progrès soient accomplis dans ce domaine.
Pour des informations supplémentaires :
Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira, Communication et Plaidoyer, Bureau du Coordinateur Résident, +221 77 462 29 28, papa.sakhojimbira@un.org, Système des Nations Unies au Sénégal
Moussa Diop, Spécialiste de la Communication, UNICEF, +221 77 644 33 22, modiop@unicef.org
Miguel Caldeira, Communication Officer, Office of the Special Representative on Violence against Children, email: caldeira1@un.org
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
1 / 11